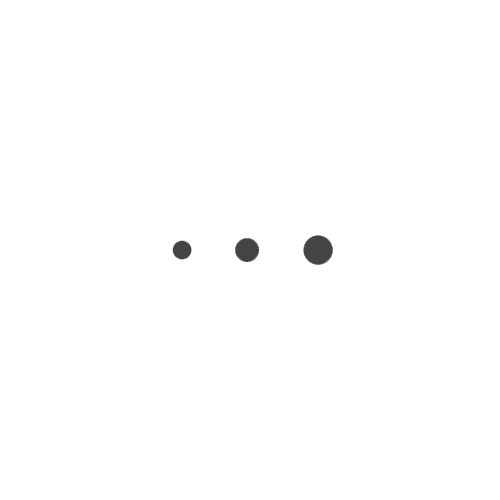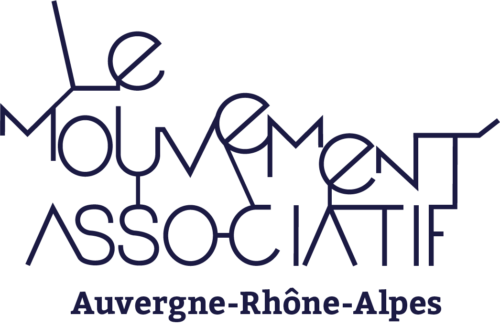Nous vous présentons officiellement le guide pratique de la recherche participative.
La charte des sciences et recherches participatives en France (publiée en 2017) définit ces sciences et recherches comme « des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent, avec des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée. »
La définition de la recherche participative donnée dans la charte du réseau francophone des boutiques des sciences est la suivante : « les parties prenantes concernées par les questions de recherche sont impliquées dans la recherche et prennent part aux choix méthodologiques« . Ce réseau partage également « une visée d’émancipation et d’autonomisation de tous les acteurs impliqués dans les recherches […] et la reconnaissance de l’expertise des demandeurs ».
En ligne sur notre site internet depuis octobre 2024 et issu des ateliers organisés par nos soins, d’entretiens et de la littérature sur le sujet, ce guide vous propose une approche didactique et pratique pour aborder la recherche participative dans les associations. Vous y trouverez notamment des idées de solutions face aux enjeux les plus fréquemment rencontrés par les personnes impliquées dans ce type de recherche, notamment côté associatif.
Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes aux rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l’Économie Sociale et Solidaire

L’occasion pour nous de vous dire que nous animerons, par l’intermédiaire de Arnaud Thenoz, la semi-plénière du 27 mai intitulée « Enquêter : les coulisses de la recherche participative avec l’ESS », lors des rencontres du Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et Solidaire (RIUESS), qui ont lieu du 26 au 28 mai 2025 à Lyon.
Le cadre autour des recherches participatives : nous notons que, si pour certains enjeux, les associations et chercheurs·euses ont les cartes en main, pour d’autres cela nécessite de le faire évoluer.
- Le temps long : quels espaces de rencontre ?
Comme pour tout projet en partenariat, la confiance et la compréhension mutuelle entre des structures aux fonctionnements différents demande du temps et des occasions de se rencontrer. Or, ces espaces sont aujourd’hui peu ou pas reconnus et financés : l’amorçage des projets et la phase d’émergence se font en-dehors des cadres de financement, les boutiques des sciences sont encore peu nombreuses, les évènements comme ceux organisés par le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes pour alimenter ce guide entrent difficilement dans les priorités des pouvoirs publics… Pourtant, les retours des personnes participantes à ces espaces sont très positifs et elles demandent d’animer ce type de démarche à l’avenir.
Certains dispositifs de soutien à la recherche participative répertoriés dans un récent travail de Sciences citoyennes permettent de reconnaitre et financer l’amorçage de ces projets, comme le dispositif d’amorçage de l’INSERM, ou le projet TISSAGE porté par l’université de Rennes. Les séminaires « faire société, faire sciences ensemble » de la Boutique des sciences de Lyon 2 dans le cadre du projet LYSIERES participent également à la construction d’espaces de rencontre entre universitaires et associations pour créer une confiance mutuelle. Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes avait participé à organiser et animer un atelier et une conférence sur l’enjeu « libertés associatives et libertés académiques, mêmes enjeux ? » le 18/09/2024.
- L’inégal accès aux leviers financiers pour la recherche
Si plusieurs appels à projets prévoient désormais de cofinancer des associations pour créer des connaissances actionnables, la majeure partie des financements pour la recherche ne leur sont pas ouverts. Par ailleurs, les associations disposent de moins d’outils que les structures lucratives pour mener des recherches. Le Crédit Impôt Recherche (CIR) par exemple n’est par nature mobilisable que par les structures imposables. Le CIR représente 6 milliards d’euros annuels, desquels les associations non lucratives sont exclues : reconnaitre leur expertise et leur capacité d’innovation passe également par l’adaptation des outils.
- L’appel à projet : un cadre de coopération et de financement souvent inadapté
Les sujets des appels à projets de recherche, participative ou non, présentent les mêmes limites que tout appel à projet : inadéquation entre les thèmes imposés par les financeurs et les enjeux portés par les personnes en recherche, temporalité différente de celle des partenaires impliqués, lourdeur administrative et délais de paiement bloquant l’entrée de structures dont la trésorerie et les Richesses Humaines sont moindres…
A Bruxelles, le programme Co-create propose trois types de projet en fonction du caractère exploratoire et innovant des projets : projet de Co-problématisation, Projet de Co-recherche, Projet de Co-développement. Ce programme existe depuis 2015, et ne fonctionne pas par appel à projet. L’accompagnement des partenaires des recherches participatives est adapté en fonction de leurs besoins, pour soutenir les initiatives au plus près de leurs réalités.
- Une ouverture démocratique
Proposer des espaces de rencontre entre des profils hétérogènes, reconnaitre l’expertise des associations sur les sujets de société dont elles traitent, mettre la production de connaissances au service des besoins des personnes impliquées et concernées par ces actions associatives, les soutenir de manière souple…sont autant de façons de soutenir une recherche à visée démocratique.
Dans le chapitre « Démocratie dans la recherche » de son rapport de 2022, le collectif Horizon Terre propose une vision des liens entre démocratie et modalités de définition des priorités de recherche. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2025 par l’Assemblée nationale, ce collectif propose une solution originale : démocratiser la programmation de recherche en instituant un cadre ouvert et participatif par le biais d’une « Convention Citoyenne de Programmation de Recherche (CCPR), chargée de décider de l’avenir de 10 % du budget de recherche ».